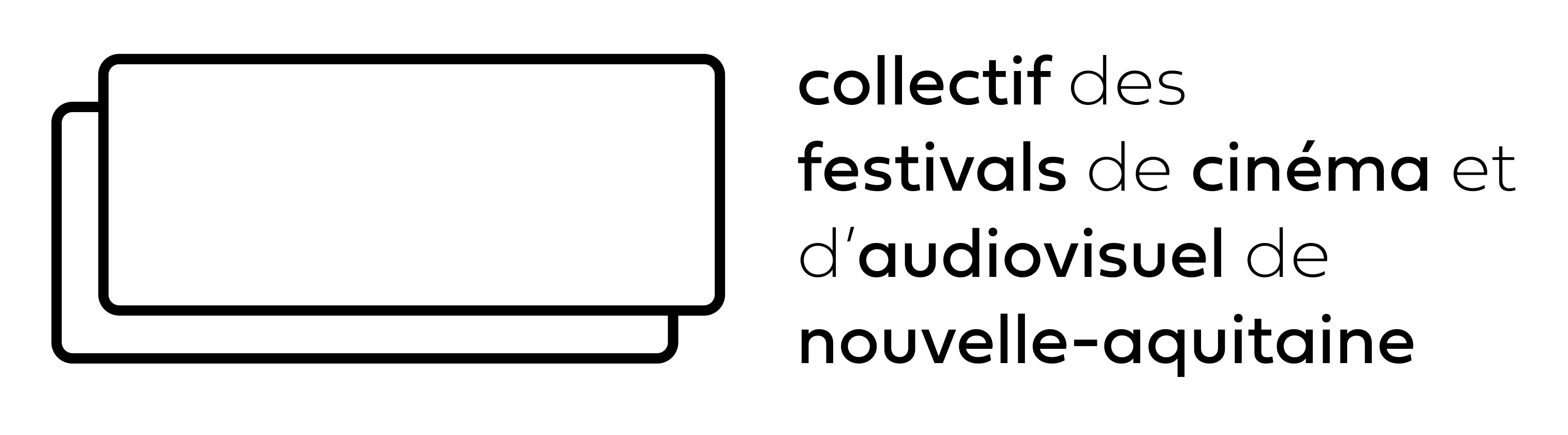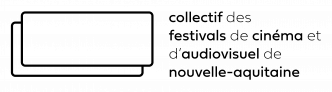L’inclusion
Après l’écoresponsabilité en 2022 et le travail en 2023, Le collectif des festivals de cinéma de Nouvelle-Aquitaine aborde en 2024 la thématique de l’inclusion et organise trois temps de formation :
- « Le genre, la parité, les violences et le harcèlement sexiste et sexuel » en avril lors du Festival de cinéma de Brive, en partenariat avec ALCA
- « Le handicap et l’accessibilité » en juillet à La Rochelle lors du Fema
- « La diversité ethno-raciale et sociale » en septembre à Biarritz lors du FBAL
Le genre, la parité, les violences et le harcèlement sexiste et sexuel
Le mercredi 10 avril 2024, dans le cadre du Festival du cinéma de Brive
Journée thématique sur la question de l’inclusion : le genre, la parité, les violences et le harcèlement sexiste et sexuel, organisée par
le Collectif des Festivals de Cinéma et d’Audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine et ALCA Nouvelle-Aquitaine
- Genres et parité : comment aborder la question du genre et de la parité, tant au niveau des contenus artistiques que des équipes (permanents, contrats ponctuels, bénévoles), dans le cadre de nos manifestations.
- Prévention des VHSS : dans nos manifestations, dans nos équipes et sur les tournages.
Intervenant.e.s : Mathy Mendy, Collectif 50/50 – Marie Renard – Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité – Chloé Munich et Gaëlle Rhodes, Centre Alice Guy CIDFF – Thomas Delemer, Chloé Laneplaine, AFDAS – Aude Merlet, AUDIENS – Leslie Thomas, CNC • Modération : Chloé Folens
Retranscription des échanges
Introduction, Maguy Cisterne, Secrétaire Générale du Festival du Cinéma de Brive et Bruno Boutleux, Président d’ALCA Nouvelle-Aquitaine
Cette journée sera organisée en deux temps. La matinée sera consacrée à la question du genre et de la parité, et l’après-midi aux VHSS en collaboration avec ALCA. Cette journée a été programmée en fonction de nos préoccupations communes, ALCA s’orientant plus sur les filières, et le Collectif plutôt sur les organisations de festivals. (MC)
Bienvenue, en effet avec le Collectif des Festivals, ALCA a souhaité proposer une journée globale autour de ces sujets sensibles, notamment les VHSS. Je suis très heureux d’organiser cette journée, car effectivement il ne faut pas tenir pour acquis tous ces questionnements. L’actualité le prouve tous les jours. Je pense que c’est un sillon qu’il faut creuser encore plus, c’est même une obligation permanente pour les organisations comme les nôtre aujourd’hui de continuer de travailler sur ces sujets, car il reste beaucoup à faire. Je suis heureux que ALCA commence à travailler sur ces questionnements, et je souhaite que cela perdure. (BB) — Lire la suite (pdf)
Retranscription des échanges
Chloé Folens, animatrice de la journée : Cette table ronde va porter sur la lutte contre les VHSS. Nous sommes en compagnie de Aude Merlet (direction communication chez AUDIENS), Thomas Delemer et Chloé Lanceplaine (conseillers emploi à l’AFDAS), Mathy Mendy (Collectif 50/50), Sophie Lainé (directrice de casting et administratrice du collectif 50/50) et Baptiste Heynemann (délégué général de la Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son). Nous serons rejoints par Leslie Thomas (secrétaire générale du CNC).
Le travail du Collectif 50/50 a été crucial avec la mise en place de dispositifs de prévention aux VHSS renforcés. Ce sont des dispositifs qui existent dans le Code du Travail, il y a une obligation légale et le CNC ainsi que le ministère de la Culture s’en sont emparé et ont adapté les dispositifs en fonction des différents métiers.
Sophie Lainé (Directrice de casting et administratrice du collectif 50/50) : À la création du collectif il y a 6 ans à peu près, les VHSS ont très vite été un sujet important (pour donner suite aux affaires liées au mouvement #MeToo, et à l’affaire Weinstein plus particulièrement). Nous nous sommes rendu compte que les VHSS, dans nos métiers, étaient liées au fait que les hommes sont majoritairement à la tête de beaucoup de choses. Donc, peut-être qu’opter pour la parité permettait de remettre en cause ce pouvoir de domination. Le premier travail que nous avons fait : création du livre blanc, qui est presque comme une étude universitaire (cela a duré environ 2 ans). — Lire la suite (pdf)